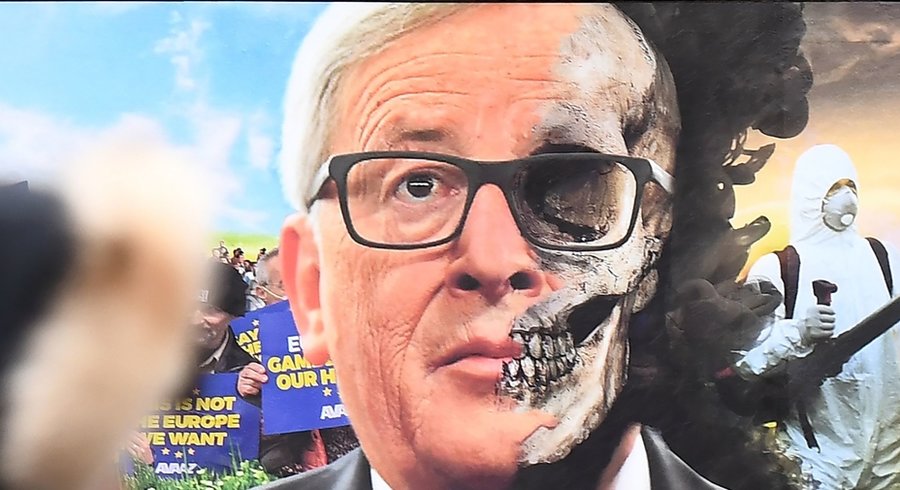Postulat déposé le 14 décembre 2017 au Conseil national
Le Conseil fédéral est prié de proposer, dans le cadre des adaptations ou modifications à venir du Code de procédure civile (CPC), une possibilité pour le juge de conciliation de délivrer une autorisation de procéder au demandeur sans tenir d’audience, lorsque la partie défenderesse a annoncé son défaut après réception de la convocation.
Développement
Le CPC a introduit le principe que la conciliation précède la procédure ordinaire. L’objectif, louable, manque toutefois complètement son but lorsque les parties défenderesses ne se présentent pas à la séance de conciliation.
Dans ces situations, la conciliation n’a pour résultat que de rallonger la procédure de plusieurs semaines, voire mois, sans créer d’espace propice à trouver une solution transactionnelle entre les parties.
Or, il n’est pas rare que les défendeurs annoncent, par l’intermédiaire de leur mandataire, leur absence de l’audience de conciliation. Dans ces cas, le juge de la conciliation est tenu d’organiser une audience inutile dont l’issue est connue de tous. Le demandeur doit attendre une séance de conciliation qu’il sait ne pourra pas se tenir, et se déplacer dans le seul but de recevoir une autorisation de procéder qui aurait pu lui être adressée par poste.
Pour alléger le travail de la justice, pour réduire les coûts de procédure à charge des justiciables et réduire la durée des procès, il est proposé que le juge puisse, lorsque le défendeur annonce son absence de l’audience de conciliation, délivrer directement une autorisation de procéder.