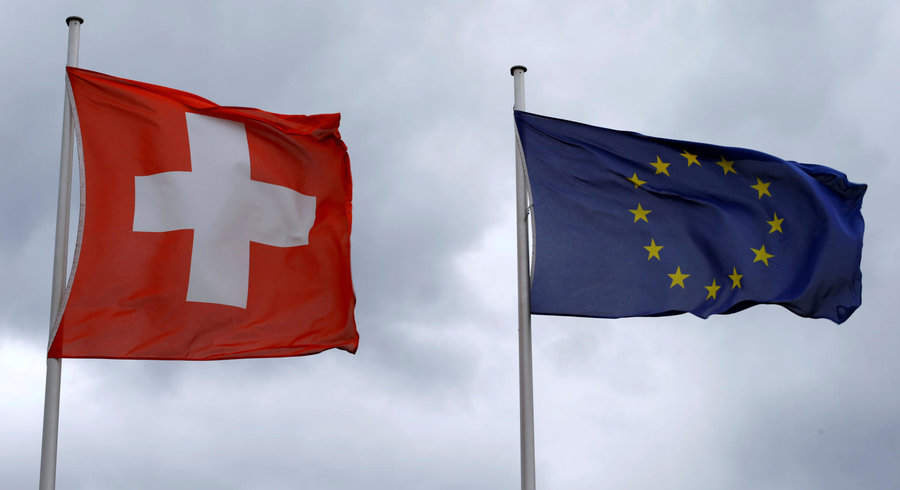Avec deux tiers de cantons opposés, l’initiative a largement échoué en votation populaire. Les appels à réformer le système résonnent comme les regrets de mauvais joueurs qui n’acceptent pas les règles une fois la partie terminée.
Bien sûr, il faudra compter avec ces 50,7%. Le contre-projet déjà adopté en est la première expression. On reconnaîtra aussi la patte de cette très courte majorité populaire dans les futures évolutions du droit de la responsabilité des entreprises.
Mais ne nous leurrons pas: avec seulement un tiers des cantons favorables, l’initiative s’est pris un vrai bouillon. Il s’en est même fallu de peu que la majorité du peuple ne soit pas non plus atteinte, c’est dire.
Cette votation rappelle les élections américaines. Là où les sondages nationaux sont commentés naïvement, tandis que les enjeux véritables se jouent dans les cantons. Comme si l’on s’intéressait aux kilomètres parcourus par les joueurs de football, en ignorant sciemment le score du match.
Des airs de Trump
Dimanche, certains partisans avaient des airs de Donald Trump, avec son ridicule «I WON, BY A LOT». On a pu entendre l’indignation des élites de gauche face à l’existence de petits cantons alémaniques. Presque une hérésie antidémocratique. Pour la présidente des Jeunes socialistes, la double majorité appartient aux poubelles de l’Histoire. Roger Nordmann trompetait sa volonté de réformer le système en bazardant la majorité des cantons. Et même peut-être la remplacer par une majorité des villes. De gauche, bien entendu.
La règle n’a pourtant rien d’insolite. Réviser une Constitution, c’est laborieux. Chez nous, comme ailleurs. La plupart des démocraties modernes ont mis sous toit de tels mécanismes de check and balances, de pouvoirs et de contre-pouvoirs, pour empêcher que des majorités hasardeuses n’aboutissent à des renversements définitifs du fonctionnement du pays.
Des exemples ailleurs
Aux Etats-Unis, il faut trois quarts des Etats pour adopter un amendement à la Constitution fédérale. L’Allemagne prévoit une majorité aux deux tiers. Beaucoup exigent l’approbation des deux Chambres, à des majorités qualifiées, puis un vote populaire. Sans parler de ceux qui exigent encore l’adhésion du roi.
Notre initiative populaire vise à changer la Constitution. La modifier impose quelques formalités particulières qui rendent l’exercice moins accessible aux forces trop révolutionnaires. A l’inverse, le référendum permet de combattre une loi. Et là, les régions les plus peuplées sont avantagées pour contrecarrer les projets portés par les deux Chambres fédérales. C’est un de ces équilibres dont nous avons le secret et qui a fait ses preuves. Dimanche encore une fois.