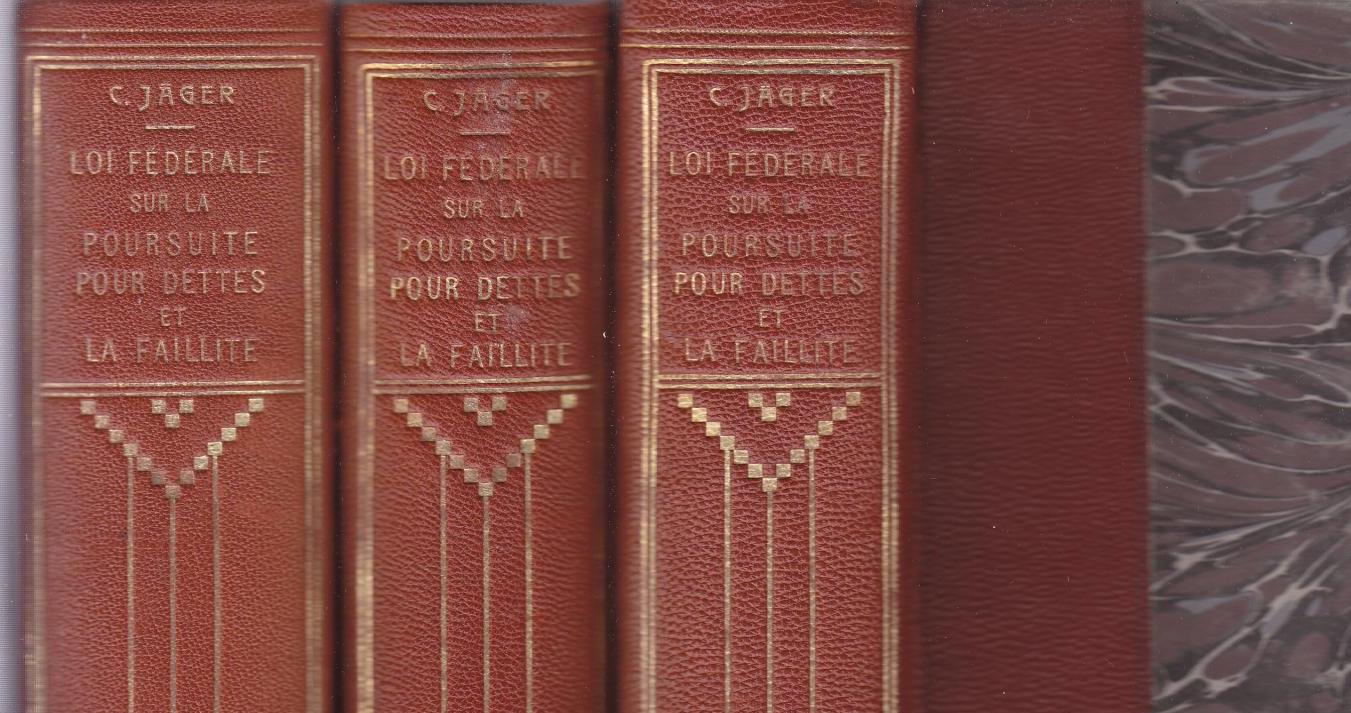Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la législation sur les médicaments afin d’autoriser l’Institut suisse des produits thérapeutiques à s’autosaisir afin d’élargir certaines homologations lorsque celles-ci s’avèrent trop restreintes ou incohérentes avec la pratique clinique et le principe d’économicité. Le Conseil fédéral est chargé de définir les conditions de cette autosaisine et la manière dont les fournisseurs de prestation, les assureurs, ainsi que les représentants des patients et des consommateurs peuvent alerter Swissmedic.
Motion déposée le 9 mars 2020.
L’autorisation de mise sur le marché est régie par Swissmedic qui, sur la base des demandes formulées par les fabricants, décide si un produit peut être vendu sur le marché helvétique et à quelles conditions. En l’état, Swissmedic ne statue que sur le périmètre défini par les fabricants.
Ces derniers peuvent ainsi demander des homologations différentes et volontairement partielles, par exemple en limitant les modes d’administration selon les dosages, ou différer les demandes d’homologation pour certaines indications pourtant cliniquement valables. Dans certains cas, cette possibilité est exploitée par les fabricants à des seules fins commerciales, comme dans celui du Velcade (voir l’interpellation 19.4211) ou celui de l’Avastin et du Lucentis. Swissmedic n’a aucune emprise sur l’étendue des homologations, elle ne peut intervenir sans la demande exprès du fabricant.
Lorsque ces produits figurent sur la liste des spécialités, il est pourtant légitime que les pouvoirs publics puissent intervenir dans un souci d’économie et agir sur les homologations. Dans cette optique, il est nécessaire de modifier la loi sur les produits thérapeutiques afin d’autoriser Swissmedic à intervenir, en particulier lorsque, à composition similaire, ou à effet similaire, des révisions d’homologation sur des produits déjà autorisés permettrait des économies importantes. Il ne s’agit pas de donner compétences à Swissmedic pour intervenir sur le type conditionnement (Iv.Pa 19.508) ni à réviser les articles 71a à d LAMal (motion 19.3285). Il vise à lui attribuer des prérogatives pour donner plus de cohérence à un système d’homologation parfois trop segmenté et, dès lors, peu économe.