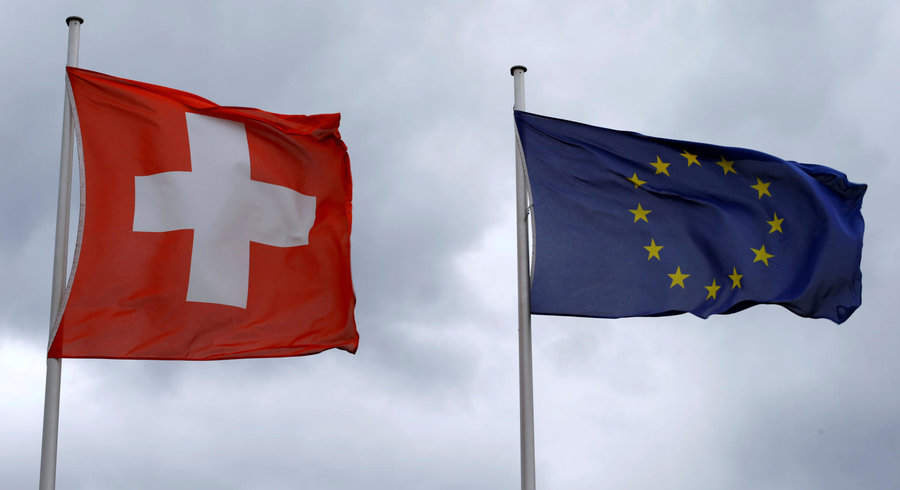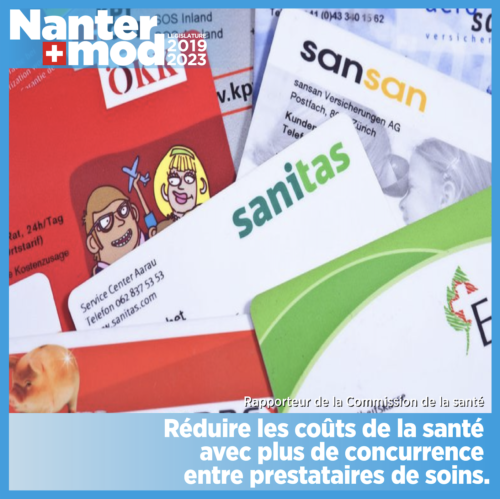Le désastre économique de la pandémie se traduit de manière très concrète pour les petits indépendants, les PME et les employés du privé. Dans ce contexte, les plaintes de certains syndicats de la fonction publique sonnent particulièrement faux.
Deux mille vingt, annus horribilis, c’est maintenant connu. Il n’y a rien de bien original à considérer que l’année qui a vu s’abattre sur notre monde la pandémie de covid est à ranger dans la catégorie de celles que l’on aurait volontiers évitées.
D’abord, il y a les victimes, pour lesquelles cette année pourrie sera la dernière. Quoi qu’en disent les complotistes de tout poil pour qui le virus est un mauvais gag inspiré par Bill Gates, leur nombre dépasse amplement le million. Cela sans parler des rescapés: tous n’en reviennent pas la fleur au fusil.
Et puis, bien entendu, il y a le volet économique de la crise. Un désastre qui ne connaît pas beaucoup de comparaisons. Un compatriote sur huit bénéficie des fameuses RHT, la réduction de l’horaire de travail. Le mot pudique pour dire chômage technique. Le taux de sans-emplois, lui, a augmenté de moitié. A leurs côtés, on trouve ces nombreux indépendants, chauffeurs de taxi, professionnels de l’événementiel, hôteliers, qui se retrouvent parfois sans aucun revenu, passant entre les mailles d’un filet social que le Conseil fédéral a tenté, tant bien que mal, de bricoler en milieu de pandémie. Sans oublier ces entreprises, petites et moyennes, des exploitations liquidées ou précipitées vers une faillite attendue. C’est parfois le travail de toute une vie qui se trouve laminé.
Face à ces drames humains, j’ai été frappé ces derniers jours par une certaine indécence. Celle de ces professeurs d’université qui se disent à bout de forces un mois après la rentrée. Ou de leurs étudiants, éreintés à la seule idée de suivre assis leurs cours en ligne. Et, surtout, de ces manifestants de la fonction publique genevoise, vent debout contre une proposition de loi qui mènerait à réduire leur revenu d’un malheureux pour cent.
On ne demande à personne de se réjouir d’une baisse de salaire ou d’une péjoration de ses conditions de travail. Mais au temps où l’ensemble de la société se serre la ceinture face à un cataclysme sanitaire et économique, au moment où les employés du secteur privé espèrent avoir encore un travail à Noël, les plaintes, cuillère en argent dans la bouche, d’une partie de la fonction publique qui bénéficie d’une complète sécurité de l’emploi, confinent à la grossièreté.