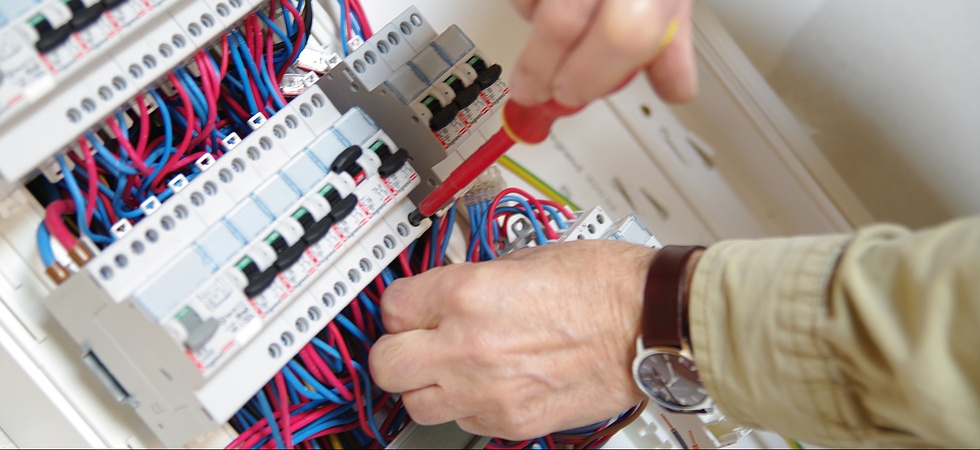Publié dans l’Agefi, le 16 mars 2016
L’origine du mal
Pour faire un mauvais jeu de mot, on pourrait dire que le débat énergétique est devenu passablement électrique. En l’espace de quelques jours, le Conseil national a décidé de subventionner la production hydro-électrique et Alpiq, groupe qui gère plus du quart de la production d’électricité de Suisse, a annoncé sa volonté de céder ses barrages aux plus offrants.
Il n’en fallait pas plus pour que les partisans d’une économie planifiée rappellent leur attachement aux monopoles étatiques, proposent la nationalisation des infrastructures et accusent la prétendue libéralisation de tous les maux. Ce n’est pas tant qu’un socialiste comme M. le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard se positionne dans ce sens qui surprend, mais plutôt qu’une cohorte d’élus prétendument libéraux le suive.
Est-ce la libéralisation du marché de l’électricité qui a causé la gabegie actuelle ? Non. Jusqu’en 2011, les entreprises du secteur agissaient comme des offreurs raisonnables : elles investissaient dans des projets de qualité, rentables, avec la prudence que l’on peut attendre de sociétés de cette taille. Cette année-là, suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, les Etats de tout le continent se sont alors mêlés de production électrique. Au lieu d’interdire simplement l’atome, par crainte de manquer de courant, les élus se sont mis en tête de subventionner massivement les énergies renouvelables, à coup de dizaines de milliards d’euros par année.
Le résultat de cette politique était prévisible. Plutôt que de choisir des projets rentables, les compagnies ont participé à la création d’une bulle électrique. Dès lors que l’Etat finançait les investissements, la production a explosé, sans tenir compte des besoins, avec pour effet un effondrement du prix de l’électricité qui rend les barrages déficitaires et pousse leurs propriétaires à mendier à leur tour les subventions publiques. Des projets intelligents comme le rehaussement du Grimsel, obtenu de haute lutte après des années de négociation, ont simplement été abandonnés, pour les remplacer par des infrastructures déficitaires et financées par des taxes.
A l’heure de la transition énergétique, on peut difficilement imaginer une politique aussi absurde : non seulement les barrages ont perdu toute leur valeur, mais avec un prix de l’électricité ridiculement bas, on a supprimé tout incitatif à économiser le courant.
Le problème ne vient donc pas de la libéralisation, mais d’un interventionnisme aussi massif que malvenu, avec ses milliards de subventions, face auquel les tenants du tout à l’Etat proposent encore davantage de subventions. Aujourd’hui, le marché électrique ressemble au Tour de France où, plutôt que de lutter contre le dopage, chacun augmente sa dose en espérant ne pas être le premier à en mourir.
Racheter les barrages et vivre un Swissair de l’électricité
Déficitaires, ces installations sont en vente parce que leurs propriétaires ne comptent plus en tirer de bénéfices. Or, il n’existe aucun devoir de l’Etat de supporter les risques liés à l’exploitation des barrages en les rachetant.
Certains affirment que la souveraineté nationale est en jeu. Le mot fait peur, mais son usage est abusif. La Suisse, pas plus que les autres pays du continent, ne vit en autarcie, et c’est tant mieux : comme disait Bastiat, si ce ne sont pas les biens qui traversent les frontières, ce sont les soldats.
La prise de participation de sociétés privées, même étrangères, n’est pas forcément une mauvaise affaire. Non seulement les infrastructures en question ne peuvent pas être délocalisées, mais toutes les conditions relatives à l’exploitation sont fixées par notre législation en matière d’environnement, d’assurances, d’entretien, de sécurité, etc. Ce n’est pas une souveraineté électrique fantasmée que l’on risque de perdre, mais uniquement les risques liés à l’exploitation des barrages, qui se traduisent actuellement par d’importantes pertes.
Faut-il, comme le propose M. Maillard, réintroduire un monopole public, et fixer les prix dans la loi ? Cette intervention sur les prix, on la vit maintenant, avec les subventions massives et leur funeste conséquence. Des prix élevés sont intéressants pour les producteurs, mais mauvais pour les consommateurs. L’Etat est-il plus à même que le marché pour trouver le juste prix ? Poser la question, c’est y répondre.
Aujourd’hui, les petits consommateurs ne peuvent pas bénéficier d’un marché électrique libre qui leur permettrait de profiter des prix bas. Le marché fonctionnait jusqu’à l’introduction d’une politique énergétique européenne interventionniste, il faut faire machine arrière.
A contrario, racheter les barrages, c’est demander à l’Etat de se charger d’une tâche qu’il ne maîtrise pas pour garder quelques infrastructures en mains suisses, qui finiront probablement et malgré tout vendues aux spécialistes du secteur. Tout cela au nom d’un patriotisme économique éculé. Nous connaîtrons alors un Swissair, de l’électricité cette fois.