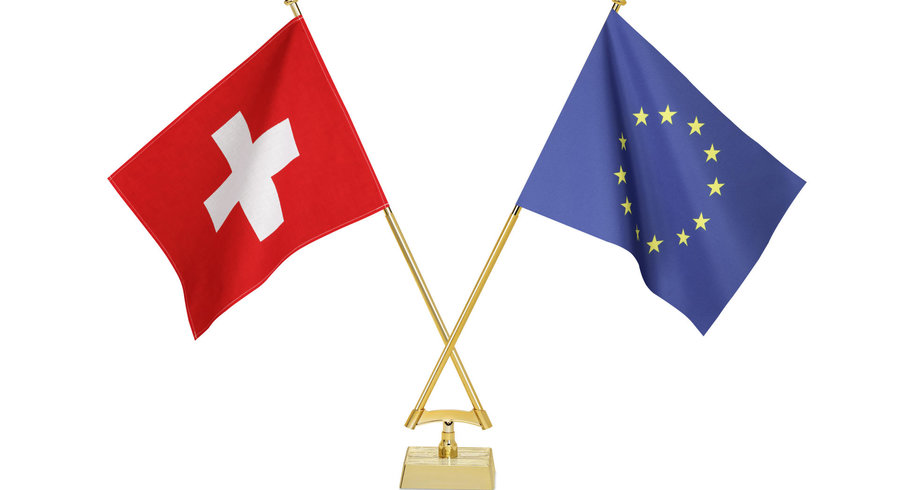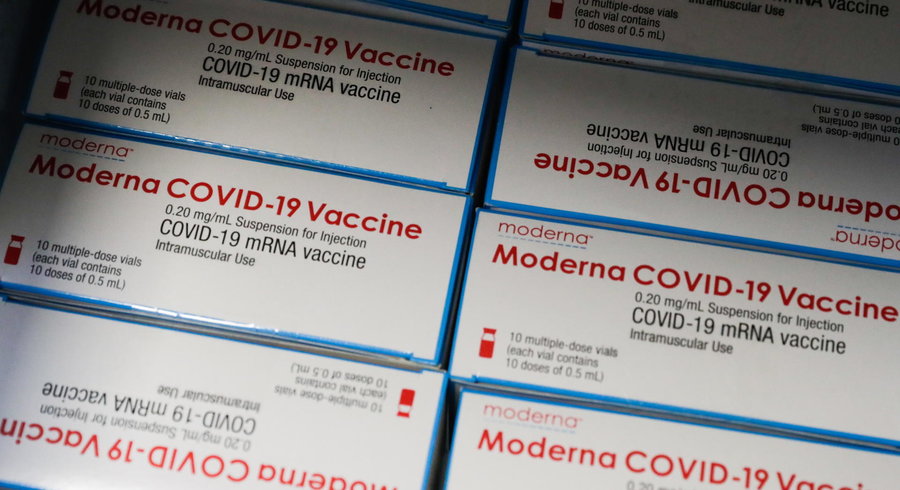L’OCDE appuie sans hésiter la demande de Joe Biden pour un impôt minimum contre les entreprises. Comme petite nation, nous devrions nous en offusquer.
Il n’aura pas fallu trois mois à la nouvelle administration Biden pour reprendre le travail du dernier démocrate et ses rêves de fiscalité mondiale.
Et il aura suffi d’une petite semaine pour que l’OCDE et son expert-chef en fiscalité, Pascal Saint-Aman, celui-là même que la communauté internationale a exempté du paiement de tout impôt, adopte le discours du super-percepteur américain et prône à son tour la guerre des fiscalités.
Toutes les raisons sont bonnes pour payer plus. L’Etat a toujours besoin de nouvelles ressources pour réaliser ses infinis projets. Les crises justifient à tour de rôle l’endettement et la fiscalisation. Or, puisque les collectivités ne créent pas de richesses mais les consomment, il faudra toujours trouver une tête de Turc qui passera à la caisse pour les autres.
En 2011, avec FATCA, les personnes physiques étaient dans le viseur. Ce fut ensuite le tour des héritiers. Aujourd’hui, ce sont les entreprises. Elles suscitent nécessairement la méfiance, ces organisations qui ont réussi à survivre aux confinements et aux interdictions de travailler. Autant les taxer davantage. Un minimum. Le minimum prévu dans le pays de Joe Biden, par un hasard toujours bien fait.
Ces chantres de « plus d’impôts pour les autres » exposent que les fiscalités moins spoliatrices que les leurs relèvent de la concurrence déloyale. Les pays qui ont décidé de dépenser moins que les Etats-Unis seraient juste des mauvais coucheurs. Ils ne joueraient pas le jeu en n’appliquant pas le programme mondialement reconnu et apprécié du nouveau démocrate de la Maison Blanche. Il faudra bien les punir, ces spéculateurs.
L’impôt finance l’Etat. Et si l’on décide demain d’uniformiser toutes les recettes publiques, il faudra logiquement en faire autant des dépenses. Abandonner l’idée pourtant séduisante que chaque nation, chaque communauté de destin puisse décider souverainement des buts collectifs qu’elle se fixe et des moyens qu’elle se donne pour y parvenir. Non, demain, chacun devra prélever la même chose, et donc dépenser autant.
Ces fantasmes d’uniformisation ne sont rien de plus que la négation du droit des nations de s’organiser librement. Ils sont l’expression du mépris de la cigale qui, non contente d’avoir chanté tout l’été, demande l’aide de l’araignée pour dévaliser la fourmilière, l’hiver approchant. Les démocrates, au sens premier du terme, feraient bien de se lever contre ces tentatives funestes de nouveau colonialisme fiscal. Et rappeler à l’OCDE que le droit international et ses organisations sont là pour protéger la souveraineté des petites nations contre la loi du plus fort.