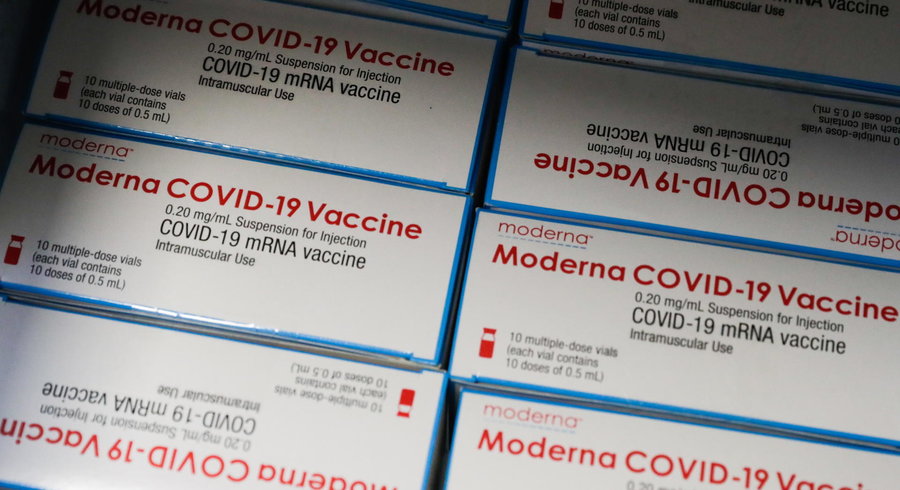Dans le cadre de la révision de la LAMal, j’ai proposé et obtenu une majorité pour un nouvel instrument pour réduire les coûts : un mécanisme d’encouragement aux rabais.
Ce mécanisme incite les assureurs à mettre en concurrence les fournisseurs de prestations (pharmas, fournisseurs de matériel médical, cliniques, laboratoires, etc.) pour obtenir des prix meilleurs que ceux qui sont fixés dans les conventions et tarifs publics.
En pratique, l’assureur pourra utiliser librement un quart du rabais négocié. Les trois-quarts restants seront obligatoirement en faveur de l’assuré.
En détail
Avec la LAMal, les prix des prestations sont fixés par des conventions tarifaires ou par des tarifs publics. Par exemple, le Tarmed définit le coût des consultations médicales ambulatoires, le DRG celui des prestations hospitalières. La Confédération fixe, d’entente avec les fournisseurs, le prix des médicaments ou des appareils médicaux.
Ces prix indicatifs constituent le maximum à rembourser par l’assurance. Celle-ci peut tout à fait s’entendre avec un fournisseur de prestation pour payer un prix inférieur. Malheureusement, cette possibilité n’est pas ou peu utilisée.
Pourquoi ? L’assurance n’a pas de ressources pour le faire : chaque franc économisé n’est en réalité pas dépensé et ne saurait être ajouté aux dépenses de l’assurance. En pratique, si une assurance consacre des ressources pour négocier des tarifs à la baisse, elle verra ses frais administratifs augmenter pour des prestations en diminution, ce qui la pénalise. Par ailleurs, l’assurance ayant l’obligation de restituer l’intégralité des excédents, elle ne peut bénéficier du moindre centime économisé : il n’y a aucun incitatif à chercher de telles économies.
Le modèle proposé change le système. En pouvant utiliser librement un quart des économies négociées, les assurances disposeront enfin des moyens pour entamer de telles négociations. Elles seront aussi réellement incitées à les ouvrir.
Les assurés bénéficieront de leur côté, pour chaque franc en faveur de l’assurance, de trois francs pour eux. Une solution win-win évidente.
Questions – réponses
Est-ce qu’avec cette proposition, les prestations seront moins bonnes ?
En pratique, les prestations qui pourraient faire l’objet de négociations sont celles qui sont très standardisées : imagerie médicale, analyses, appareils et matériel médical, médicaments. La qualité de ces prestations n’est pas surveillée par l’assurance, mais par les autorités en matière médicale et les homologations. Il n’y a aucune raison que la qualité soit impactée d’une manière ou d’une autre.
L’assurance-maladie pourra réaliser un bénéfice. C’est la fin du système social ?
Le 25% n’est pas un bénéfice pour l’assureur, mais un montant à sa libre disposition. Ce montant pourra être utilisé d’abord pour financer les ressources nécessaires à la réalisation de ces économies (négociation, mise en place des circuits d’approvisionnement, etc.). Il pourra aussi être partagé avec l’assuré pour l’encourager à choisir le partenaire avec lequel la négociation a été menée, ou avec le partenaire lui-même.
Il n’est pas totalement exclu que certaines assurances puissent réaliser un bénéfice sur cette part, c’est vrai. Mais aujourd’hui, les assurances ne sont pour la plupart pas organisées pour réaliser du bénéfice, celui-ci finirait tout de même en réserves.
- Toutefois, quand bien des assurances s’organisaient pour réaliser un bénéfice, il faut se rappeler qu’il ne pourrait être réalisé qu’à condition que l’assuré touche trois fois plus.
- L’interdiction de faire du bénéfice n’a jamais empêché jusqu’ici l’augmentation des primes d’assurance-maladie. Il est absurde de s’interdire une mesure qui pourrait créer de vraies économies en faveur de l’assuré au nom d’un principe qui n’a jamais fait ses preuves.
- Le projet de loi prévoit des garde-fous : l’OFSP peut limiter les montants librement disponibles par l’assurance en cas d’abus.
- Pour pouvoir bénéficier du montant à libre disposition, l’assurance doit prouver l’économie, ce qui impose une totale transparence.
En résumé, cette proposition introduira un vrai incitatif à faire baisser les prix, ce qui bénéficiera avant tout aux assurés payeurs de prime. Une mesure concrète et simple en faveur des assurés !
Cette solution poussera les assurances à maintenir des prix publics chers pour négocier des tarifs à la baisse ?
Cette hypothèse paraît peu probable. Les conventions tarifaires ne sont pas fixées unilatéralement par les assurances, mais sont négociées. Par ailleurs, elles sont le fruit de négociations entre les fédérations d’assureurs, pas des assurances elles-mêmes. Enfin, les conventions tarifaires sont surveillées par l’OFSP qui pourra refuser des conventions abusives dans une telle situation.
Il faut aussi souligner que les domaines les plus standardisés, donc les plus concernés par la mesure, ne sont pas régis par des conventions, mais par des tarifs fixés uniquement par la Confédération (matériel médical et médicaments notamment).