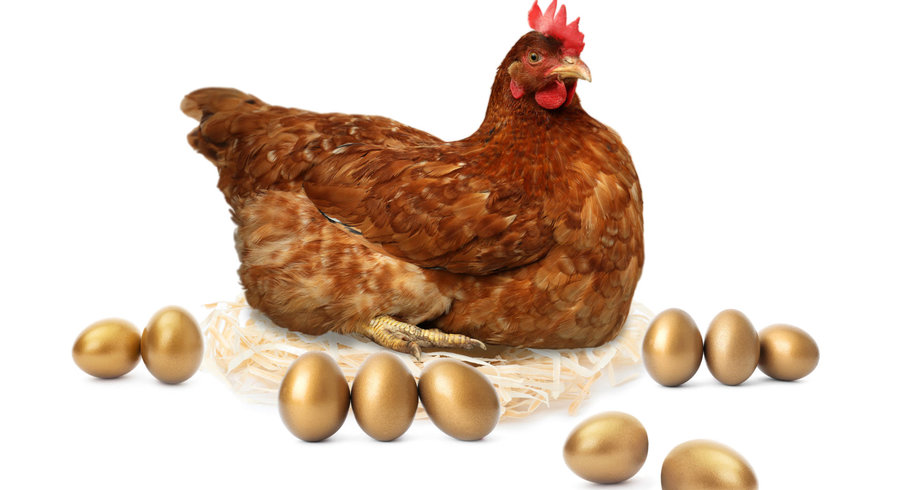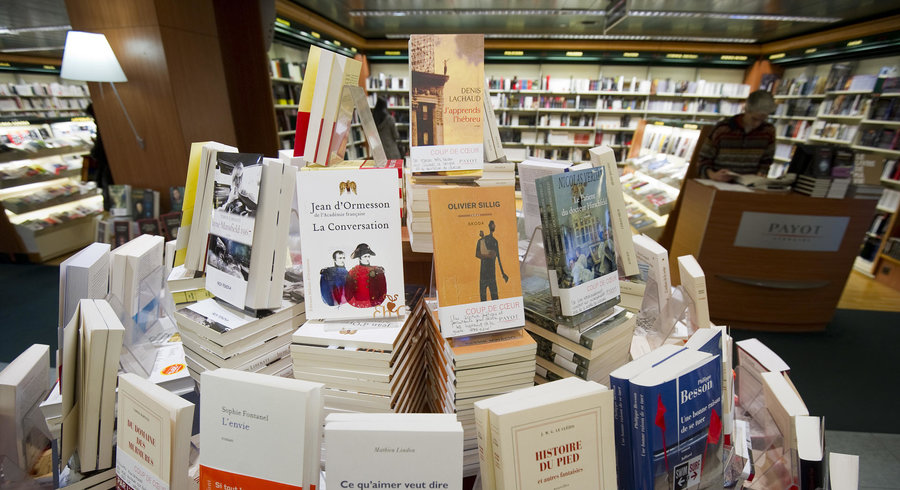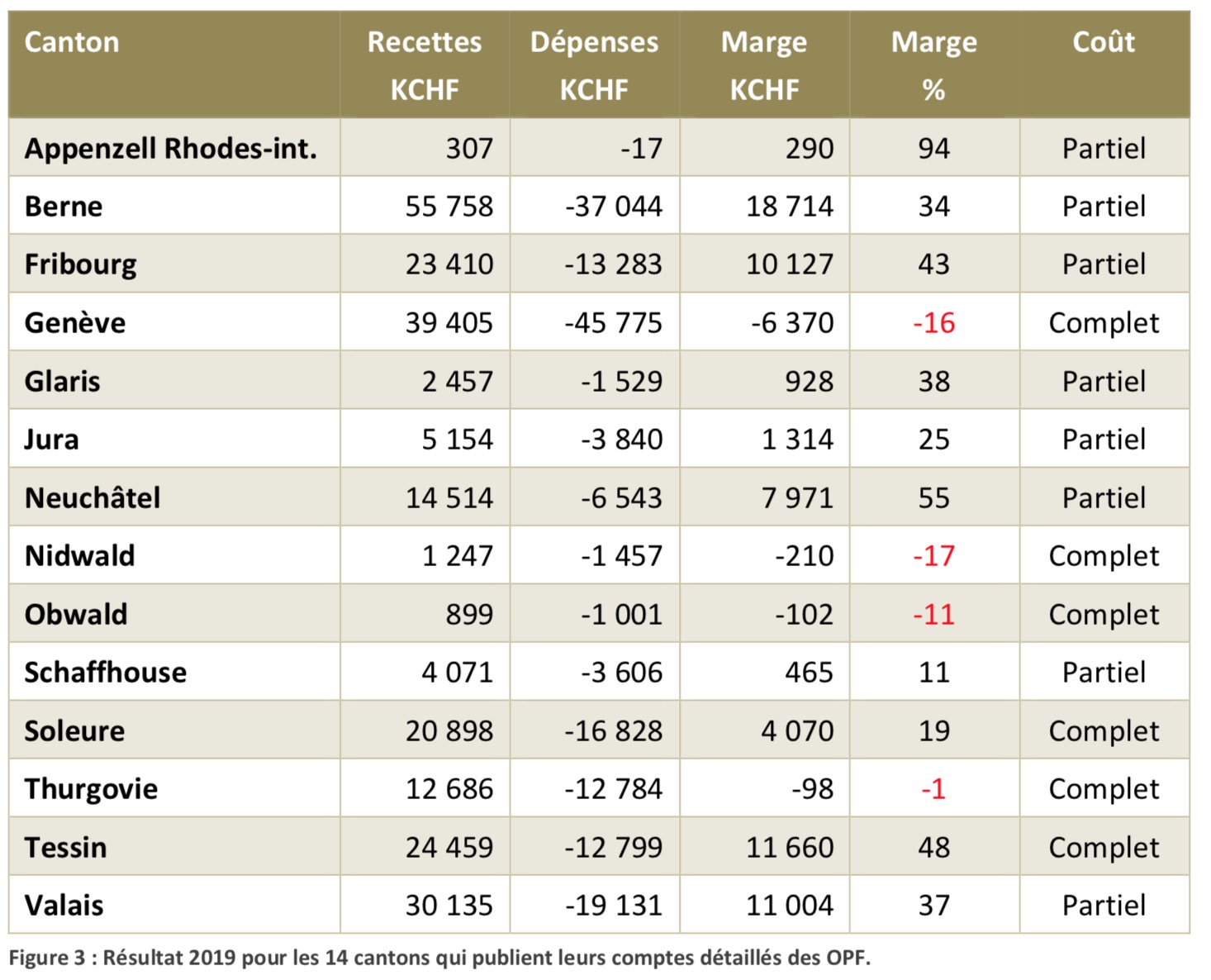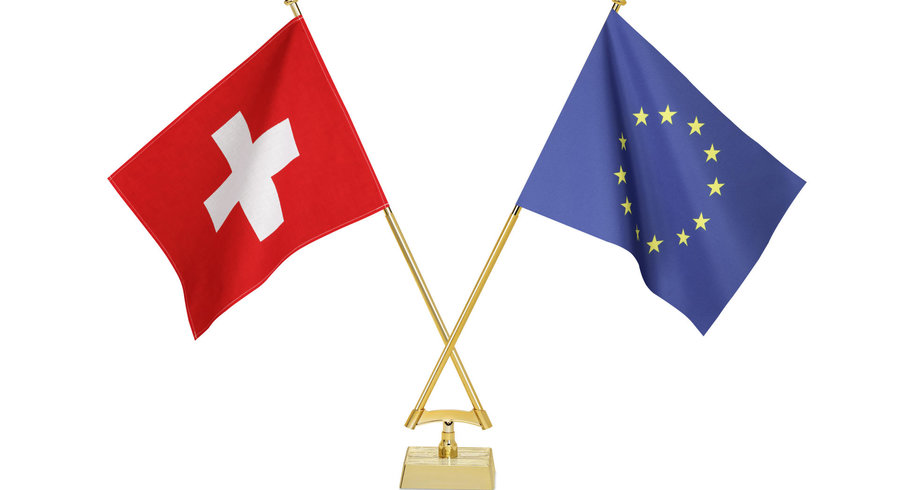Le projet de levée des brevets des vaccins contre le Covid-19 met en péril la recherche à long terme. Contre les nouveaux variants, mais aussi contre les futurs virus. Et cela ne répondra à aucun besoin concret sanitaire, uniquement idéologique.
Les fables de La Fontaine regorgent de bons principes dont on devrait s’inspirer. Malheureusement, on s’arrête trop souvent au milieu des histoires, en négligeant sciemment la morale de l’affaire.
Prenez la poule aux œufs d’or. Pas le jeu télévisé amoral, mais la fable. Le fermier, impatient de voir sa poule ne pondre qu’un œuf d’or par jour, finit par la trucider en espérant y trouver un trésor. Et Jean de La Fontaine de conclure: «L’avarice perd tout en voulant tout gagner.»
Dans nos démocraties occidentales, le plus beau de nos biens, notre poule aux œufs d’or, c’est sans doute notre capacité d’innovation. Ces grandes universités, ces entreprises qui vous envoient dans l’espace ou ces chercheurs qui inventent des microprocesseurs de la taille d’un atome.
Il nous aura fallu des siècles pour nous débarrasser de la rage, de la peste ou de la polio. C’est l’intelligence qui a vaincu. De 1900 à 2000, les progrès de la science ont permis d’augmenter l’espérance de vie de 49 à 80 ans. Inlassablement, notre poule aux œufs d’or a produit ces petits miracles technologiques qui rendent le monde meilleur.
Vous me voyez venir. En à peine six mois, des laboratoires du monde entier sont parvenus à créer une solution hyper-efficace pour mettre un terme à un fléau que nous n’avions pas connu depuis cent ans, le Covid-19. Avec un succès extraordinaire. Et selon les prévisions, on devrait disposer d’au moins une dose par être humain d’ici à la fin de l’année.
Alors, que demander de plus?
Comme dans la fable, tuer la poule. Une certaine gauche altermondialiste, emmenée par Joe Biden, s’offusque moins de la pandémie que du succès des firmes qui lui ont trouvé une parade: il faudrait au plus vite exproprier les brevets. On dépècera la bête, on extirpera l’ARN de son estomac et chacun fabriquera des vaccins dans sa cuisine.
A suivre les efforts de Lonza pour augmenter sa production de Viège – déléguée par Moderna, faut-il le rappeler? – la partie s’annonce plus compliquée. On peut aussi douter que la poule déplumée produira encore beaucoup de remèdes contre les futurs virus qu’on nous annonce par légions ou contre les variants aux noms de pays tropicaux. Et puis, les besoins en vaccins étant couverts d’ici à la fin de l’année grâce à l’industrie, le projet américain répond davantage à des visées doctrinales que sanitaires.
Si le temps donne raison à Joe Biden, nous laisserons alors aux administrations publiques et aux idéologues de tout poil le soin d’inventer les remèdes contre les nouvelles maladies. Et l’on mourra probablement plus longtemps, mais dans l’égalité et la fraternité.