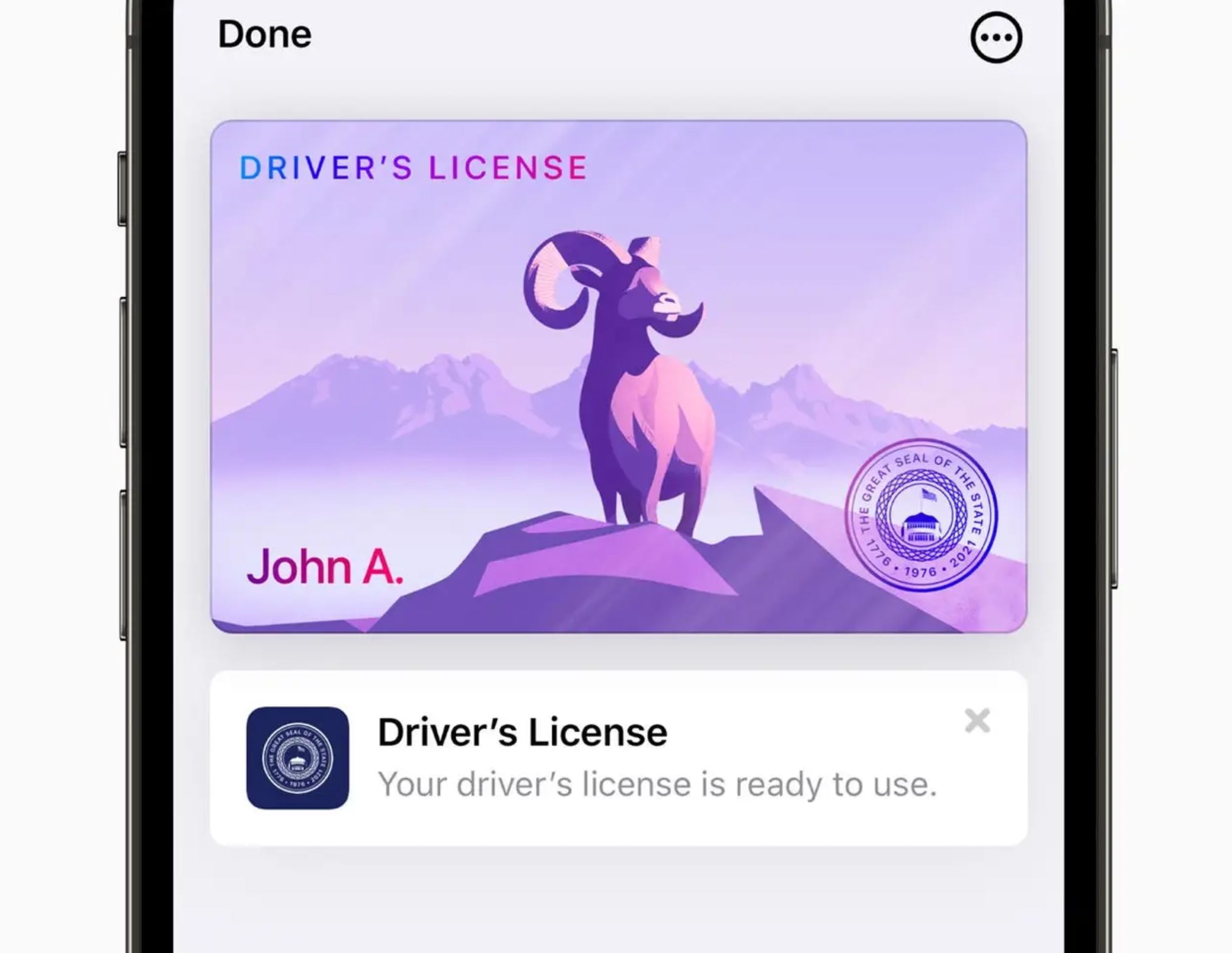Les contingents d’arrivée en Suisse pour les étrangers de pays extraeuropéens nuisent à la propsérité de la Suisse quand ils touchent les travailleurs qualifiés dont a besoin notre économie. J’ai repris et défendu la motion de Fathi Derder sur le sujet, qui a été acceptée par le Conseil national.
Motion
Texte
Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification de la législation sur les étrangers pour remplacer le modèle actuel de contingentements pour les ressortissants d’Etat dits tiers (hors UE/AELE) par un mécanisme plus adapté aux besoins de l’économie, en particulier dans les secteurs de pointe où la main-d’oeuvre indigène fait défaut.
Développement
La politique migratoire suisse a fait l’objet de restrictions importantes au cours des dernières années. L’adoption de l’initiative sur l’immigration de masse en 2014 et les crises économiques des années 2008 et suivantes ont conduit le pays à adopter une législation prudente en matière d’immigration.
Cinq ans après l’adoption par le peuple de ladite initiative, on constate que les politiques publiques ont permis une réduction importante du solde migratoire. La situation économique a aussi fortement changé: le taux de chômage en Suisse et en Europe atteint des niveaux historiquement faibles.
Aujourd’hui, l’économie suisse a besoin d’une mise à jour du modèle de contingentement. De nombreuses sociétés actives dans des domaines de pointe ne parviennent plus à trouver la main-d’oeuvre nécessaire en Suisse et même en Europe. En plus de la forte concurrence étrangère, l’innovation suisse est confrontée à des chicanes administratives qui ne protègent pas l’emploi en Suisse. Au contraire, ces contingents mettent en péril le développement de projets à forte valeur ajoutée, et donc de prospérité et d’emploi en Suisse à long terme.
La présente motion invite le Conseil fédéral à proposer une nouvelle solution, en remplaçant les contingents par un mécanisme plus souple. Toutes les options doivent être sur la table: octroi au canton de la compétence de délivrer des permis sans restriction dans des domaines particuliers, établissement de conditions claires sur ces autorisations, surveillance de l’administration.
Argumentation
Avec la libre circulation des personnes, la politique migratoire des trois cercles a fait place à la politique migratoire des deux cercles, c’est-à-dire que les personnes en provenance des Etats extraeuropéens qui veulent venir travailler en Suisse sont soumises à des contingents. En 2021, ces contingents se dénombrent comme suit: 8500 spécialistes en tout; 4500 peuvent bénéficier d’un permis B et 4000 d’un permis L. Ces permis sont distribués canton par canton pour moitié et sont dans les mains de la Confédération pour l’autre moitié.
Or on constate que l’économie suisse a besoin d’une mise à jour de ce modèle de contingentement. De nombreuses sociétés actives dans des domaines de pointe ne parviennent plus à trouver la main-d’oeuvre nécessaire ni en Suisse, ni même en Europe. En plus de la forte concurrence étrangère, les entreprises suisses innovantes sont ainsi confrontées à des chicanes administratives qui ne protègent pas du tout l’emploi en Suisse. Au contraire, ces contingents mettent en péril le développement de projets à forte valeur ajoutée et donc, à long terme, la prospérité et l’emploi dans notre pays. Par exemple, les grands noms de la technologie sont limités dans leurs possibilités de faire venir en Suisse des chercheurs, des chefs de projet. Or, avec eux, ce sont souvent des unités de recherche et de production qui peuvent être créées en Suisse, avec des emplois à la clé.
Notre politique migratoire doit servir aussi nos intérêts. Il est parfaitement inutile d’imposer des barrières contre-productives qui poussent les entreprises suisses à créer des emplois à l’étranger – là où ces barrières n’existent pas – plutôt que chez nous.
Je suis bien entendu conscient du fait que le Conseil fédéral travaille afin de trouver des solutions qui puissent être plus souples dans l’intérêt des entreprises concernées. Je suis aussi conscient qu’il y a une forte pression populaire, puisqu’il y a eu en 2014 une votation sur une initiative populaire dont le but était une limitation plus grande du contingentement. Toutefois, un juste équilibre doit être trouvé entre les impératifs de démocratie populaire qui veulent un contingentement et ces mêmes impératifs qui demandent que l’immigration servent les intérêts de la Suisse.
C’est pour cela que la motion de notre ancien collègue Derder vise à ce que le Conseil fédéral inscrive dans la loi des mécanismes plus souples, par exemple en reprenant les conclusions du futur rapport que vous devrez rédiger pour mettre en oeuvre le postulat que j’avais déposé et que notre chambre avait accepté. Ces mécanismes peuvent être, par exemple, un contingent plus élevé, avec une possibilité d’échanges entre les cantons, ce qui est actuellement impossible, ou la levée du contingent pour certains secteurs. Je ne doute pas d’ailleurs que l’administration a d’autres idées lumineuses pour résoudre ce problème. Ces solutions sont indispensables.
Récemment, nous avons parlé de la problématique dans le domaine de la vaccination. J’ai été informé qu’en réalité l’administration avait pu apporter les solutions nécessaires et qu’il n’y avait pas de problème dans ce domaine. Cela dit, cela aurait pu être le cas et cela aurait été un bon exemple.
En fin de compte, nous avons besoin d’une immigration adaptée aux besoins de l’économie et des citoyens de notre pays, et cela passe par une adaptation du système de contingentement.