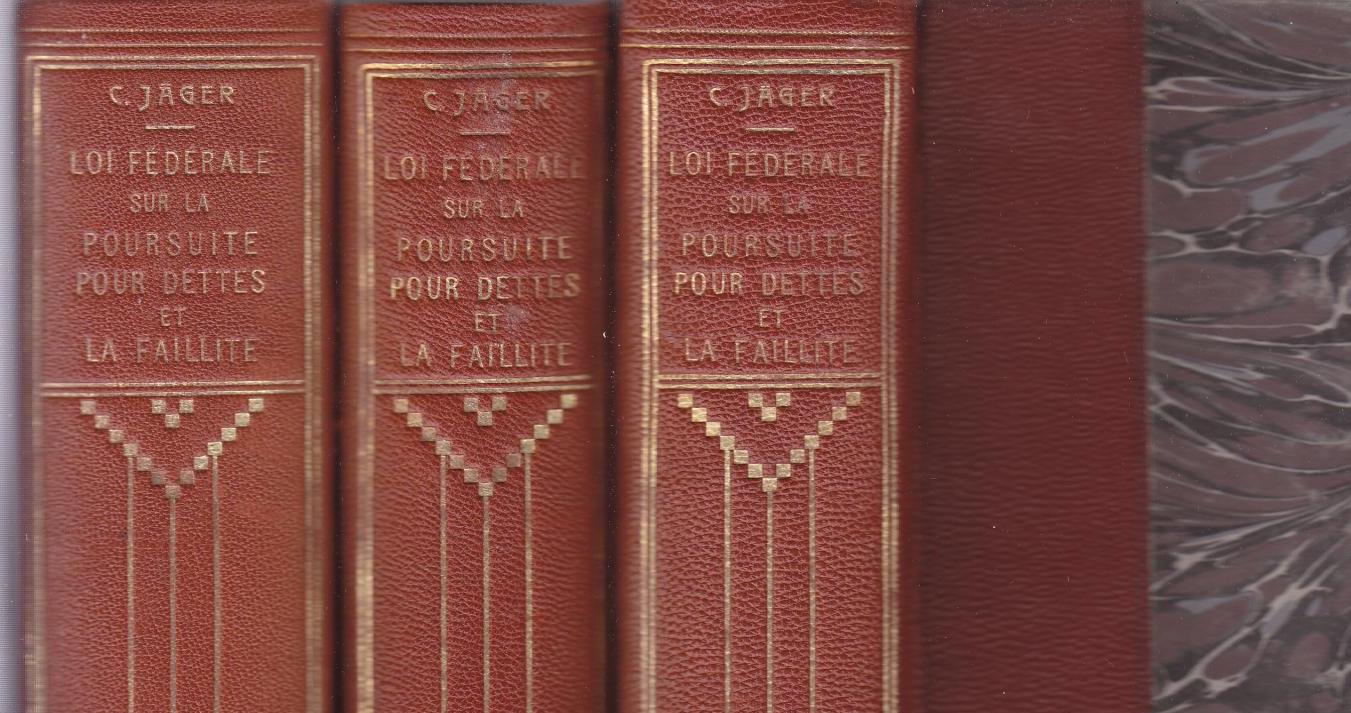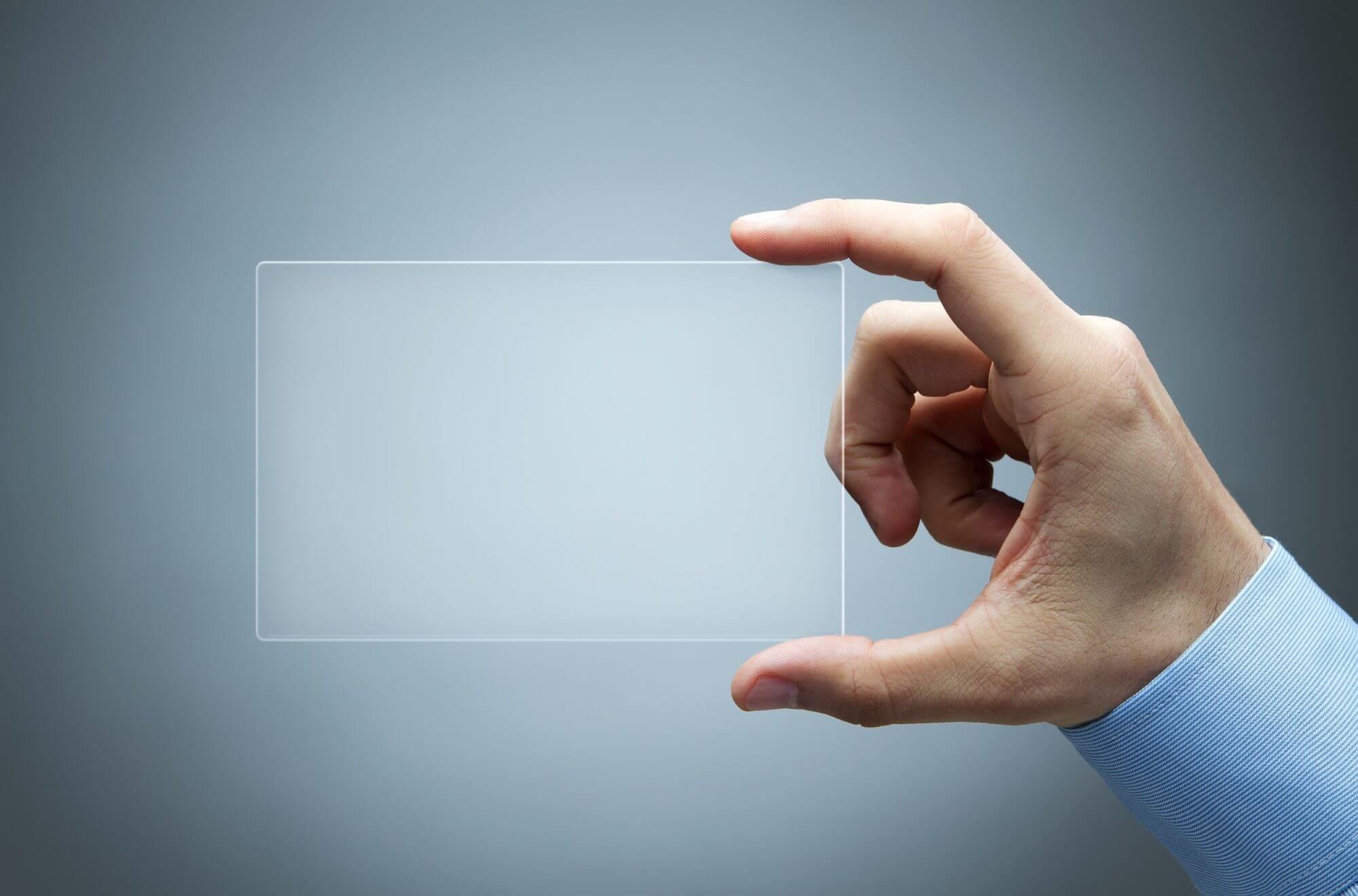La session de printemps du Conseil national fut notamment marquée par la réforme de l’assurance invalidité. Deux jours de débats. Comme rapporteur de commission, je les ai suivis dans tous leurs détails techniques et politiques. Ma conclusion : nous avons adopté une réforme équilibrée et porteuse d’avenir.
Or, la presse et la gauche ne se sont arrêtés qu’à la mesure d’économie, sans même évoquer les grands éléments de la réforme, leur cœur de la réforme.
L’assurance invalidité revient de loin. Souvenez-vous. C’était en 2008. La sixième révision de l’AI entrait en vigueur, suivie d’une augmentation temporaire de la TVA en 2011. A l’époque, l’AI était littéralement surendettée et continuait de creuser son déficit année après année. En 2009, l’AI perdait encore 1.1 milliard de francs par année.
Pascal Couchepin était aux commandes à l’époque. Son objectif paraissait illusoire : assainir l’AI tout en offrant de meilleures perspectives aux rentiers. Une dizaine d’années plus tard, force est de constater qu’il a réussi.
Le nombre de nouvelles rentes a fortement diminué : de 28’000 en 2003 on est passé à 14’000 en 2016. Le travail des offices AI a permis de maintenir ou de réinsérer sur le marché du travail plus de 20’000 personnes en 2016, contre seulement 6’000 en 2008. Cette évolution est extrêmement positive et elle se retrouve sur les comptes de l’assurance. Sur le plan financier, depuis 2011, la dette de l’AI a pu être réduite de 3.5 milliards de francs, pour s’établir encore à 11.4 milliards de francs aujourd’hui.
Fort de ces expériences, le Conseil national a donc décidé de poursuivre la réforme. Contrairement à ce que l’on peut lire, la révision adoptée n’a pas pour seul objectif l’assainissement de l’assurance. Le parlement a décidé, au contraire, de renforcer encore les mesures de réinsertion, d’étendre certaines prestations pour les rentiers, et de financer tout cela de manière équilibrée au sein de l’assurance. Jugez-en par vous-même.
S’agissant des plus jeunes, la réforme renforce considérablement, pour 40 millions de francs par année, la prise en charge des infirmités congénitales et de maladies rares. La liste des situations prise en charge sera réadaptée et allongée.
Les jeunes de 13 à 25 ans bénéficieront désormais de détection précoce et de mesures de réinsertion très concrètes : des places d’apprentissage financées par l’AI, des mesures d’accompagnement dès la fin de la scolarité obligatoire.
Enfin, les personnes atteintes dans leur santé psychique profiteront d’un accompagnement et d’un conseil renforcé et plus adapté pouvoir maintenir l’employabilité et la réinsertion. D’autres mesures, notamment en ce qui concerne la location de services, seront introduites.
Par ailleurs, le système de rentes par pallier est largement adouci. Contrairement à ce qui prévaut aujourd’hui, les assurés subiront moins les effets de seuil actuels. Les rentes seront linéaires et nous éviterons désormais la situation actuelle où, par exemple, le passage d’un taux d’incapacité de 49% à 50% entraine un doublement de la rente.
Au total, ces mesures supplémentaires entrainent des dépenses supplémentaires de 160 millions de francs par année. C’est généralement un investissement dans l’avenir des personnes concernées. Les succès des réformes précédentes devrait, on l’espère, se répéter ici.
Depuis une dizaine d’années, les Suisses ont contribué largement au renflouement des caisses de l’AI. On est encore loin de parvenir au désendettement de l’assurance. Mais on y travaille. Il était en tout cas exclu pour le parlement de retomber dans la spirale d’endettement de l’assurance que l’on a connu durant les années 1990 et 2000. Les citoyens n’ont pas payé un supplément de TVA pour tout démolir quelques années plus tard.
Alors forcément, des économies ont été réalisées pour réduire le déficit et financer les nouvelles mesures. On parle principalement de la réduction de l’allocation parentale, soit le supplément offert aux parents à l’AI pour leurs enfants, de 40% à 30%. En pratique, cela signifie une réduction de la rente pour les personnes concernées de 140 à 130, soit d’environ 7%. Ce n’est évidemment pas de gaité de cœur que cette mesure-là a été prise. Mais elle apparaît comme proportionnée et nécessaire.
Gardons à l’esprit que chaque franc d’économie est intégralement réinvesti dans l’AI. Pour l’essentiel, sous la forme de nouvelles prestations, pour une autre partie, pour continuer le désendettement qui a commencé à la fin des années 2000. La réforme ne prévoit aucune réduction des moyens de l’assurance, contrairement à ce que l’on a pu lire.
Toutes ces mesures n’ont qu’un seul objectif. Continuer la transformation de l’AI d’une assurance de rente à une assurance de réinsertion. Les premiers résultats sont très positifs, il est essentiel de poursuivre dans cette voie. C’est ce qu’a fait le Conseil national en mars, on peut s’en réjouir.